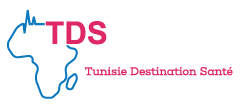Insémination artificielle avec sperme du conjoint (IAC)
L’IAC qu’est-ce que c’est ?
L’insémination artificielle avec sperme du conjoint (IAC) est une technique qui consiste à placer un échantillon de sperme du partenaire masculin du couple dans l’utérus de la patiente. Après le prélèvement, les spermatozoïdes sont traités et sélectionnés en laboratoire afin que seuls les « meilleurs » soient retenus et que les chances de fécondation soient accrues. Cette technique de fécondation assistée permet de réduire la distance entre l’ovule et le spermatozoïde et facilite la rencontre des gamètes sans qu’il soit nécessaire de recourir à un prélèvement d’ovules.
L’insémination artificielle est indiquée dans les cas de :
- Stérilité d’origine inconnue ;
- Facteurs cervicaux ou tubaires (altérations anatomiques et/ou fonctionnelles du col de l’utérus, de la glaire cervicale ou d’une ou des deux trompes de Fallope) ;
- Altérations légères à modérées de certains paramètres du liquide séminal, de sorte que les spermatozoïdes ont des difficultés à atteindre l’utérus ;
- Difficultés coïtales ou entraves aux rapports sexuels (par exemple, si la femme souffre de vaginisme ou si le partenaire masculin a subi une vasectomie ou connaît des épisodes récurrents d’impuissance) ;
L’insémination artificielle peut compenser les anomalies du sperme masculin, car la préparation de l’échantillon avant la procédure permet de séparer les spermatozoïdes viables à mobilité préservée de ceux de qualité inférieure.
L’insémination artificielle peut également être utilisée si le partenaire masculin souffre :
- Éjaculations rétrogrades (à l’intérieur de la vessie) causées par une opération de la prostate ;
- Certaines maladies de l’appareil génital, comme l’hypospadias, dans lesquelles il est difficile ou impossible d’avoir des rapports sexuels complets ;
En ce qui concerne les femmes, l’insémination artificielle est indiquée en présence de :
- Endométriose légère ;
- Dysfonctionnement ovulatoire ;
- Facteurs immunologiques (par exemple, développement d’anticorps anti-spermatozoïdes) ;
Pour être éligible à l’IAC, il est essentiel qu’au moins une des deux trompes de Fallope soit ouverte et que l’homme réponde également aux paramètres minimaux du sperme.
L’IAC peut également être réalisée chez les couples sérodiscordants pour le virus de l’immunodéficience humaine (VIH) et les virus de l’hépatite B et C. Si l’homme est porteur du virus, un lavage du sperme sera effectué avant l’utilisation de l’échantillon.
Les traitements : L’insémination intra-utérine (IAC)
Si un couple ne parvient pas à concevoir malgré des rapports sexuels ciblés sur une période de 12 à 24 mois, il est nécessaire de rechercher les causes de la difficulté à concevoir d’un point de vue clinique.
Avant de procéder à une insémination artificielle avec sperme du conjoint, le médecin rencontre les deux patients et établit une anamnèse sur la base de leurs antécédents médicaux. Il prescrit ensuite une série d’examens spécifiques afin d’écarter les dysfonctionnements hormonaux, les pathologies utérines et tubaires, les anomalies du liquide séminal, etc.
Si les conditions constatées ne peuvent être gérées par une intervention pharmacologique et/ou chirurgicale, c’est-à-dire si la procréation est impossible ou si la probabilité d’une grossesse est faible, la procréation médicalement assistée peut être indiquée.
En fonction de la cause de l’infertilité, le spécialiste du centre PMA peut recommander une insémination artificielle ou une autre procédure plus adaptée au profil du couple.
Déclenchement de l’ovulation en IAC : comment cela se passe-t-il?
L’insémination artificielle avec sperme du conjoint peut être effectuée sur un cycle spontané ou avec une stimulation de l’ovulation, à partir du deuxième ou troisième jour après le début du cycle menstruel.
L’objectif est d’inciter les ovaires à produire plus d’un follicule et d’obtenir la maturation simultanée de 2 ou 3 ovules, afin d’augmenter les chances qu’au moins l’un d’entre eux soit fécondé.
La surveillance de l’ovulation par échographie, effectuée au cours du traitement, permet d’ajuster la dose de médicament pour optimiser la réponse ovarienne.
En fonction de la taille des follicules et de l’épaisseur de la muqueuse utérine, il est possible de prédire le moment de l’ovulation dans le cycle en cours.
En général, dès que deux ou trois follicules atteignent une certaine taille (environ 18 mm), l’ovulation est provoquée par l’injection de gonadotrophine chorionique humaine (hCG), afin de pouvoir choisir le moment le plus approprié pour l’insémination.
DEVIS EXPRESS
Vous souhaitez avoir plus de renseignements
Recueil et préparation du sperme IAC
Le liquide séminal nécessaire à l’insémination artificielle est obtenu par masturbation après 2-5 jours d’abstinence (pour augmenter le taux de spermatozoïdes) ou par ponction du canal déférent.
L’échantillon ainsi obtenu subit une préparation spéciale en laboratoire, c’est-à-dire qu’il est traité de manière à sélectionner et à concentrer les spermatozoïdes mobiles dans un volume suffisant.
Insémination artificielle : comment ça se passe ?
Le jour de l’insémination artificielle est fixé 36 heures après l’administration de l’HCG. Le liquide séminal du conjoint, préalablement examiné et sélectionné, est libéré dans l’appareil reproducteur de la patiente (selon la méthode : cavité utérine, canal cervical ou trompes) via un fin cathéter.
Le processus est simple, indolore et très similaire à tout examen gynécologique.
Au bout de 14 jours après l’insémination, un dosage de l’hCG plasmatique est effectué pour vérifier si une grossesse a été établie avec succès.
Combien de temps attendre entre 2 inséminations artificielles
Le délai recommandé entre deux inséminations artificielles dépend de divers facteurs, tels que l’état de santé général de la patiente, les résultats des traitements précédents et les objectifs de fertilité du couple. En général, les spécialistes de la fertilité recommandent d’attendre au moins un cycle menstruel complet avant de planifier une autre insémination artificielle.
Ce délai permet au corps de la femme de récupérer après le traitement précédent et de se préparer pour le prochain cycle menstruel. En outre, cela permet aux spécialistes de la fertilité de surveiller l’ovulation de la femme et d’ajuster le traitement en conséquence pour maximiser les chances de succès.
Il est également important de noter que la fréquence des inséminations artificielles peut varier en fonction de la situation individuelle de chaque couple. Parfois, il peut être nécessaire de faire plusieurs cycles d’insémination artificielle avant de concevoir, tandis que d’autres couples peuvent réussir dès la première tentative.
Il est donc essentiel de travailler en étroite collaboration avec un spécialiste de la fertilité pour déterminer le calendrier et la fréquence des inséminations artificielles en fonction de la situation individuelle de chaque couple.
En conclusion, le délai recommandé entre deux inséminations artificielles est d’au moins un cycle menstruel complet. Cependant, la fréquence des inséminations artificielles peut varier en fonction de la situation individuelle de chaque couple et doit être déterminée en collaboration avec un spécialiste de la fertilité. En suivant les conseils appropriés et en travaillant en étroite collaboration avec un spécialiste de la fertilité, de nombreux couples peuvent avoir une chance de concevoir avec succès par insémination artificielle.
Que faire après l’insémination artificielle?
L’insémination artificielle se déroule généralement sans complications et n’implique aucune manœuvre douloureuse. Les risques après l’insémination sont limités, mais la réponse aux médicaments pour induire l’ovulation doit être surveillée par des échographies des ovaires et/ou des tests hormonaux.
Si un nombre excessif de follicules se développe, le traitement doit être interrompu à temps, car le patient peut développer les conséquences suivantes :
- Grossesse multiple ;
- Le syndrome d’hyperstimulation ovarienne ;
Les autres risques liés à l’insémination artificielle sont les suivants
- Fausses couches ;
- Grossesses extra-utérines ;
Les complications qui peuvent découler de cette technique sont les suivantes :
- Infections ;
- Allergies aux composants du lavage séminal ;
- Réactions immunologiques (développement d’anticorps anti-spermatozoïdes) ;
Quel est le taux de réussite de l’insémination artificielle?
Le taux de réussite de l’insémination artificielle dépend de plusieurs facteurs tels que l’âge de la femme, la qualité du sperme, le nombre de follicules ovarien, etc. En moyenne, le taux de réussite de l’insémination artificielle est de 10 à 15% par cycle de traitement. Cependant, il est important de noter que ce taux peut varier considérablement d’une personne à l’autre. Dans certains cas, la réussite peut être obtenue dès le premier essai, tandis que dans d’autres, plusieurs tentatives peuvent être nécessaires avant d’obtenir une grossesse. Pour augmenter les chances de réussite, il est recommandé de suivre les conseils pour réussir l’insémination artificielle tels que maintenir un mode de vie sain, suivre le traitement prescrit par le médecin et éviter le stress.
Résultats insémination artificielle
L’insémination artificielle est associée à de bons résultats. La probabilité de déclencher une grossesse avec cette technique est de 10 à 15 % par cycle de traitement.
Les taux de réussite de cette technique varient en fonction de :
- Causes d’infertilité présentes dans le couple ;
- L’âge du couple ;
- Caractéristiques qualitatives et quantitatives du liquide séminal ;
- Type de stimulation pharmacologique effectuée ;
En général, si la conception ne se produit pas après 3 ou 4 cycles d’insémination artificielle avec sperme du conjoint, il est conseillé de réévaluer le cas et de passer à d’autres procédures plus sophistiquées, comme la fécondation in vitro.